Je dédie cette nouvelle à Sébastien, Martine, Bernard et Minnie. Sans eux, je n’aurais sans doute jamais visité leur beau pays. C’était en juin 2018 (souvenez-vous, la canicule). Allez à Montréal, chacun de vos pas vous enrichira.
Nous voilà installés, Vaness’ et moi, aux sièges 50H et 50G d’un Airbus A340 de la compagnie Corsair, vol CO902, en partance pour Montréal. Pour ma métisse à moi, prendre l’avion c’est comme prendre un café pour moi. Je pensais l’épater et elle s’est foutue de moi quand elle m’a vu gober mes deux Atarax dans la zone d’embarquement. J’ai eu droit à tout. Que « y’a moins de morts en avion qu’en autobus », que « l’Airbus, c’est le meilleur avion du monde » et que, coup d’grâce, « Montréal, c’est pas si loin ». C’est p’têt pas si loin mais n’empêche qu’on est obligés de prendre l’avion pour y aller et qu’un océan, pas la Manche, nous en sépare. Orly, j’aime bien Orly, ça me rappelle quand, mouflet, le « meilleur ami » de ma mère nous y conduisait, le dimanche, dans le taxi pourri de son pote, pour voir décoller ou atterrir les Caravelles. On allait toujours au même endroit, entre Orly-ville et Athis, sur un terre-plein gadouilleux mais stratégiquement situé. Au petit bonheur la chance, selon les dimanches et, sans doute, le sens du vent, on les voyait décoller ou atterrir. J’aimais mieux l’atterrissage. Grimpé sur les épaules du « meilleur ami » de ma mère (qui s’avéra beaucoup plus tard être mon père. Voir « Qui père gagne ») je pouvais les suivre plus longtemps et j’aimais les voir rebondir sur la piste au moment où les roues touchaient le sol. À l’époque je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je grimperais dans l’un d’eux. J’en rêvais certainement mais mes rêves m’envoyaient directement dans l’espace. L’océan, morose, clapote doucement dix-mille mètres sous nous. J’évite de penser car, si j’ai horreur de l’avion, j’ai aussi l’élément liquide en abomination. Vaness’ dort. Bon, je vais essayer de vous raconter pourquoi on est là. Presque des vacances. Pour la fliquette, c’en est. Pour moi, c’est une mission. Joindre l’utile à l’agréable comme on dit. D’autant que c’est la mission qui a payé les deux allers et retours. En classe ordinaire mais c’est toujours ça. J’ai une pensée pour Momo et René qui nous ont accompagnés à l’aéroport et qui sont restés cloués au sol, la larme à l’œil. Pas Momo qui ne pleure pas et qui ne prend jamais l’avion. C’est à la demande de Çémafor Yldiz, le célèbre généalogiste que vous connaissez tous, que nous avons embarqué, Van’ et moi, dans ce zinc à destination de chez nos cousins d’Amérique. Une enquête de routine dans l’intérêt des familles. Du moins de celle qui reste. Je vous explique : Vous avez sans doute appris le décès de Séraphin Lartiche, le réputé multimilliardaire célibataire, fils unique et orphelin. Vous n’avez pas pu passer à côté, ça tourne en boucle sur Facebook. Une fortune qui irait à l’état sans la pugnacité d’Yldiz qui a réussi à dégotter au de-cujus, à la faveur d’une recherche génétique, une fille naturelle qui est bien loin de se douter de ce qui lui arrive. Un peu comme moi, minot, sur les épaules de mon vieux, dans la gadoue d’Orly. Seulement, voilà, la gamine – elle a vingt-cinq ans et est née pile neuf mois après un colloque bien arrosé – est du genre pigeon voyageur. Baba cool, punkette, sans vraiment d’attaches, elle parcourt le monde sans boussole. Dorothée Lamour qu’elle s’appelle. On a un beau dossier sur elle. Bien vide. Tellement vide qu’on ne sait pas où elle est. Pourquoi le Canada alors, me demanderez-vous ? Parce que sa mère, Elisabeth Lamour, ex-hôtesse dans l’événementiel, y vit et que la petite est québécoise. Pas facile de suivre la trace de Dorothée, elle vit sans bruit, sans téléphone portable et même sans carte bancaire. Comme la majorité des anonymes qui n’ont pas les moyens de payer des impôts et qui boudent les systèmes sociaux, elle n’intéresse aucun fichier. Tout ce qu’on sait d’elle, à part son état civil tronqué côté paternel, c’est que la mère lui a envoyé un mandat Western Union à Djibouti, il y a un mois, et qu’on retrouve sa trace en qualité de passagère d’un vol pour Montréal dans la semaine qui a suivi. Basta ! Même pas de photo. Mais on sait des choses sur la maman et on a des choses à en apprendre. Pourquoi Yldiz s’intéresse-t-il à l’affaire ? Pas par philanthropisme, ni pour la beauté du geste, mais pour prendre au passage 25% de l’héritage. C’est comme ça que les généalogistes vivent. Sortes de chasseurs de primes des temps modernes. Et, à moi, il a promis vingt mille euros plus les frais. Une goutte d’eau dans l’histoire mais un grand pas pour mon compte en banque. En plus ça parait relativement facile.
Arrivés à Trudeau. Je regarde ma montre connectée. Merde on n’a pas mis deux heures ! C’est beau l’décalage ! Aéroport sympa, à taille humaine. Vanessa marche devant moi, je vis un rêve. Les formalités de débarquement se déroulent facilement et, comme on a juste chacun une valise-cabine, on est très vite dehors. C’est drôle, ça, y’a que chez nous que c’est si compliqué ? L’express Bus N°747 nous promet le centre-ville (à une vingtaine de kilomètres) en moins d’une heure. Et malgré d’importants travaux qui ralentissent la circulation, il tient ses promesses. Largement même puisqu’en moins de 45 minutes, nous voici à l’angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue Metcalfe. Et ici pas besoin de Cartoville, Vaness’ connaît comme sa poche.
– J’ai été fille au pair pendant une de mes années d’études. À McGill. Je te montrerai.
Faire ses études ici pour se retrouver lieutenant de police à Vitry, il y a des parcours qui m’étonneront toujours. Je replie mon Cartoville et lui emboite le pas, les yeux écarquillés. C’est donc ça, Montréal ! Je n’en reviens pas d’être là. Immédiatement je m’y trouve bien, chez moi. Juin doit y être aussi pour beaucoup. On remonte l’emblématique rue Sainte-Catherine jusqu’à arriver sur la rue Drummond qu’on prend à gauche. Nous avons réservé un studio au premier étage d’une sorte de maison de ville.

Le dépanneur
– Super, m’annonce ma copine, on a un dépanneur juste en face et une pharmacie pas loin.
– T’as un truc en panne et t’as oublié ta pilule ?
Elle se marre comme, sans doute, tous les québécois qui font visiter leur belle région à des français de base. Et m’explique :
– Ici, le dépanneur c’est, comme on dirait chez nous, l’arabe du coin. Il y en a partout et c’est bien pratique. Et la pharmacie c’est carrément une supérette. Mais qui vend quand même des médicaments.
En effet, je vois une file de caddies à l’entrée de celle qui fait le coin. René serait ravi. Ici il pourrait se prétendre pharmacien. L’appartement n’est pas vraiment dans la rue Drummond mais juste à l’entrée d’une petite ruelle perpendiculaire. Faudra vous y habituer, ici tout ce qui n’est pas perpendiculaire est parallèle, et inversement. Un de ces fameux escaliers extérieurs si typiques de l’architecture montréalaise nous mène directement au premier. Comme convenu, la clé se trouve sous un pot de fleur renversé sur le palier en ferraille. La confiance règne. Le studio est plutôt un loft. Mais tout est assez disproportionné ici. Pourtant Montréal n’a rien d’une mégalopole. Je pense même que c’est plus petit que Paris. La pièce, meublée très « industriel » est immense. Sauf le coin nuit qui doit prendre moins de place au sol que le frigo. Je n’ai jamais vu ça (eh non, je n’ai jamais visité Rungis !). J’inspecte la douche, elle aussi XXL, qui me paraît d’un usage pas évident. Vaness’ me bouscule, à poil. Elle ne perd pas de temps.
– Viens, il y a de la place pour deux.
Pour trois ou quatre, même. Comment décliner une telle invitation ? Même si je me sens un peu fatigué malgré l’intensité du soleil dehors qui s’invite par la grande fenêtre du fond (côté ouest). La combinaison « eau chaude-Vaness’ » (à moins que ça ne soit l’inverse) me réveille et ma première érection outre-atlantique est presque à la hauteur des proportions locales. Mais nous sommes dans une nouvelle, ne vous imaginez pas que je vais vous faire des pages de notre vie intime. On s’essuie mutuellement avec des serviettes qui ont dues être réalisées à partir de patrons de couvre-piscine. Là, pour le coup et malgré l’heure encore très raisonnable, il ne m’en faudrait pas beaucoup pour aller directement me coucher.
– Tu veux qu’on fasse quoi ? On peut remonter Drummond jusqu’au Mont-Royal. C’est pas très loin. Mais ça grimpe un peu. Après, pour manger, on aura le choix.
« Mont-Royal », mot magique. Mais pour grimper, ça grimpe et bien en ligne droite dans la pente. On traverse Sherbrooke au niveau du Ritz. Quelques très belles maisons attirent mon regard. Vaness’ ne voit rien, elle connaît déjà tout. La montée se durcit encore en passant devant de beaux immeubles. J’imagine ça l’hiver avec la neige et le verglas. Elle est sportive, ma copine, et jeune aussi. On attaque la promenade par des escaliers qui nous larguent instantanément en pleine forêt. Nous chassons des écureuils énormes et gris. Quel dépaysement ! C’est donc ça le Mont-Royal.
– On pousse au lac des castors et on redescend par la croix. Ça te va ?

Rencontre au Mont Royal
Tout me va dès l’instant qu’elle ne me demande pas de parler. Le Mont-Royal, c’est une bosse et, avant d’arriver en haut, il faut toujours grimper. La fatigue, l’activité « douche à jeun » et pourquoi pas l’altitude font que je souffle comme un bœuf. Mais on y arrive à son lac. Très beau, très serein, entouré de vastes pelouses. On le contourne par le bord. Un monsieur y manœuvre une maquette de bateau motorisée. Des joggers joggent, des vélos nous sonnent. Nous nous asseyons deux minutes sur un banc public infiniment long. À mes pieds, quelques grains de pop-corn sans doute renversés par un gamin. J’en ramasse quelques-uns avec une idée derrière la tête. On ne croirait pas qu’on est là pour bosser. Mais il est vrai que le boulot et moi… Vanessa se lève et on repart vers le nord (je le sais à cause du soleil qui se couche en Bretagne). Une allée forestière nous récupère et je surveille autour de moi. Bingo ! Un écureuil nous surveille depuis son fossé. Je fais signe à ma guide de ne pas faire de bruit et de préparer son téléphone en position photo. Je m’écarte. Je me baisse et balance un premier grain en direction de la bestiole qui, méfiante, hésite. Puis un pas, puis s’enhardit, puis attrape le maïs. Un autre grain, moins loin. Pareil. Et ainsi de suite jusqu’à ce que l’animal me mange carrément dans la main. Vaness’ mitraille en silence. Elle est un peu loin mais on recadrera. Je le tiens mon souvenir de vacances ! Il me faut peu de chose. Je me lève doucement. Fin d’une belle amitié. Le cousin à grosse queue déguerpit et disparaît. On marche sous les bois, croise des promeneurs, des sportifs. Pas loin d’arriver, selon mon guide à qui je demandais si où on en était, un belvédère nous offre une vue imprenable sur la ville et, au loin sur le port et le pont Jacques Cartier. Ma fliquette profite de l’occasion pour ramener sa science. Je dis ça mais je suis bien content du prétexte pour nous poser un peu. Elle me décrit le paysage et :
– Tu vois les buildings ? Tu ne remarques rien ?
Non, il y en a un peu partout, de toutes les formes, même un avec un toit pyramidal qui me plaît bien. Mais à part ça.
– Aucun n’est plus haut que le Mont. C’est interdit par la ville.
Ah ben oui, maintenant qu’elle le dit. Je mitraille un peu et on redémarre. Je suis déçu par la croix, sorte d’échafaudage en ferraille guère plus impressionnant qu’un pylône à haute tension. Je suis content d’apercevoir, à l’orée du bois, la civilisation et ses avenues. Nous contournons un grand stade et une très jolie rue que j’avais déjà vue sur des photos de Montréal nous ramène, en ligne droite et en descente, à Sherbrooke puis à Sainte-Catherine.
– Si tu as envie de manger chinois, le quartier chinois n’est plus très loin.
– Je préférerais plutôt local et je suis crevé.
– Bon, compris, je t’emmène au complexe Desjardins. On y arrive, c’est juste derrière la place des Arts. Comme ça tu auras une idée du Montréal souterrain où toute la ville vit l’hiver.
La place des Arts porte bien son nom. On croirait un vaste plateau cinéma, un peu le Broadway du coin. Enfin ce que j’en imagine. Tout y est dédié au spectacle. Ça grouille de techniciens qui semblent persuadés d’être les maillons forts de la culture contemporaine. « Qui se la pètent » dirait René. Je commence à marcher un peu au radar et ne capte plus grand-chose. Le complexe Desjardins est un gigantesque centre commercial qui s’enfonce, sur plusieurs niveaux (je ne suis plus en état de compter) sous les entrailles de Montréal, une des portes d’entrées importante de cette fameuse ville souterraine. On se croirait à Italie 2, dans le treizième, ou au Forum des Halles mais en beaucoup plus grand. Les ramifications s’étendent sous toute la cité.
– Tu veux du local, tu vas en avoir.
On s’installe dans un restau moderne et bondé. Beaucoup de jeunes. Organisation top, on nous installe rapidement. La carte est sur le set en papier. Comme chez nous. Je n’ai ni le temps ni le goût de trop m’y attarder et j’entends Vaness’ annoncer :
– Deux poutines et une grande bouteille d’eau pétillante.
Elle dit ça, me semble-t-il, avec l’accent local.
– Tu te fous d’eux ? m’étonné-je.
– Non, mais ça revient vite, c’est mon petit côté Lara Fabian.
– Et t’es plus végétarienne ?
En réalité, elle l’est à géométrie variable. C’est pas une intégriste du tofu.
– C’est végétarien, insiste-t-elle, mais tu verras ça cale.
Ah oui ! J’avais pas imaginé ça. Des frites avec une sorte de ketchup au goût particulier et du fromage qui fait bizarre quand on le croque. Roboratif. Après la journée qu’on a eue, c’est même exagéré.
– Tu aimes le fromage « couic-couic » ?
– Ça n’a pas trop de goût. Mais j’en mangerai pas tous les jours.
L’eau pétillante est de la Perrier. Dépaysement modéré. Après la poutine mes velléités de dessert se sont évaporées. Et tant mieux car quand je vois les parts de gâteaux passer… C’est très l’idée « américain » que je me fais de la bouffe. Je paye. Vaness’ me fait remarquer :
– Faut que tu rajoutes le service. C’est de ton initiative mais pas optionnel comme chez nous. Environ 15% de la note.
Note à laquelle on a déjà rajouté une taxe (genre TVA) qui n’est pas indiquée dans le prix du menu. Je me disais aussi que ça n’était pas très cher. Je complète donc et le serveur, « relax et jasant » comme on dirait ici, me rend la monnaie en sourires.
– Tiens, on va rentrer par l’underground, ça te donnera une idée.
En fait le sous-sol de Montréal est un méga centre commercial avec ses rues, ses directions, ses sorties. C’est vraiment une vraie ville souterraine, taupinière éclairée et climatisée. Pas difficile, à mon avis, de s’y perdre. Je repère un vaste espace convivial constitué de tables et entourés de divers enseignes de restauration ou d’épiceries fines qui proposent des plats que les consommateurs consomment sur la place centrale. Mais je n’ai plus faim et Vaness’ marche vite. Pas facile à dire mais je pense qu’on a bien fait un kilomètre, au moins, sans voir la lumière du jour. Qui s’avère être plutôt la lumière de la nuit quand on sort du labyrinthe. Je reconnais le Ritz. Nous sommes donc sur Sherbrooke. Je commence à me familiariser. On descend Drummond et on rentre.
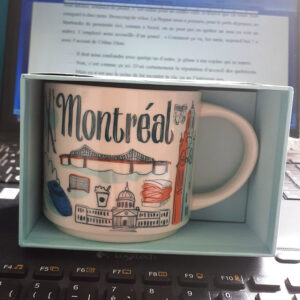
Ma tasse Starbucks
Nuit intense, sommeil de plomb. C’est calme pour un centre-ville. Je trouve que ça roule bien comparé à chez nous. Beaucoup de vélos. La flegme nous a poussés, pour le petit-déjeuner, au Starbucks de proximité (ici, comme à Séoul, on ne peut pas en quitter un sans en voir un autre). L’employé nous accueille d’un grand : « Comment ça va, les amis, aujourd’hui ? » avec l’accent de Céline Dion.
– Il doit nous confondre avec quelqu’un d’autre, je glisse à ma copine qui se marre.
– Non, c’est comme ça ici. D’où certainement la réputation d’accueil des québécois. Mais ça n’est pas la peine de lui raconter ta vie, ça ne l’intéresse pas.
L’expresso est très bon, les croissants pas mal. Evitez le café américain et précisez « court » pour l’expresso sinon c’est imbuvable. J’en profite pour acheter la tasse du coin (j’ai commencé une collection de tasses Starbucks des endroits où je vais) et on fait le point.
– On a rendez-vous avec la mère dans deux heures, je te propose qu’on y aille à pied. Le métro est ridicule et pas pratique.
– C’est loin ?
– Trois kilomètres à vue de nez. Pas loin du port, dans le vieux Montréal, le quartier que je préfère.
Changement de cap. On redescend encore plus Drummond jusqu’au boulevard René-Levesque, Puis on rejoint la rue Saint-Antoine (« René », Saint Antoine », on se croirait chez moi) en traversant le mini mais très sympa quartier chinois. Notre cliente habite et nous attend rue de l’hôpital juste derrière la basilique Notre-Dame de Montréal. Un quartier vintage et très animé. On se croirait un peu dans le Marais parisien. Vaness’ m’explique que le port n’est pas loin et qu’on rentrera par là si Elisabeth ne nous déroute pas avec ses révélations. À ce stade vous devez vous demander qu’est-ce qu’on fiche là et pourquoi Çémafor n’a pas réglé tout ça en deux ou trois coups de fil. Il a bien essayé. Mais sans résultat. Elisabeth sait donc très bien pourquoi nous débarquons. La dame, bien plus jeune que je ne me l’étais imaginée nous ouvre. Notre look doit la rassurer car elle se montre aussitôt très avenante. Sa maison est à son image : branchée. Le tutoiement est de rigueur et l’accent supportable. Elle n’en « revient pas de c’t’histoare pas croyâble », nous propose du thé. Un peu barrée la mother mais assez dans la gamme que j’aime bien. Vaness’, intuitive, prend la direction des opérations. À moins que ça soit son côté « flic » qui se réveille. Résumé de l’affaire, papotage de convivialité sur la déco et on attaque les choses sérieuses :
– Tu n’as vraiment pas d’idée d’où se trouve ta fille ?
– Aucune ! Je l’ai vue à sa descente d’avion. On a jasé dans le taxi, elle a pris une douche et m’a dit « ciao ». Mais elle est comme ça, Dorothée.
– Tu te souviens de ta rencontre avec Lartiche ?
– Je me souviens du congrès mais pas trop du bonhomme. Faut dire que ça n’a pas été triste. À l’époque je croulais sous les demandes…
Je pense, en mon for intérieur, que ça n’a pas dû beaucoup changer.
– Ça m’fait tout draôle d’apprendre qu’il est l’père de Doro. J’me suis toujours demandé lequel ça pouvait bien être. J’ai cherché sur la toâle et, en effet, y’a des airs.
Tout ça c’est bien beau, le thé est bien bon mais ça ne nous avance pas à grand-chose.
– Penses-tu qu’elle est toujours à Montréal ?
– J’en suis sûre, elle était à sec. Elle doit bosser comme serveuse au Village (quartier Gay) ou faire la manucure rue Saint-Denis dans le quartier latin. En tous cas, j’la voas pô ailleurs. Vous pensez bien que si je savais où elle est… Elle connaît encore pas mal de monde ici. Pas forcément dans l’beau monde mais elle est comme ça.
– Aurais-tu une photo d’elle ?
Elle sort son smartphone et nous sort un selfie d’elle et de son clone en plus jeune. Encore plus barré, le clone.
– Voilà, prise dans le taxi qui nous a ramassées à Trudeau. J’vous l’imprime.
Sans qu’elle bouge de son fauteuil, on entend l’imprimante qui démarre. C’est beau la technique ! Vanessa empoche le cliché et réfléchit aux questions à poser.
Pourquoi est-elle rentrée d’Afrique ?
– Elle m’a lancé un SOS. Elle était harcelée par un marabout.
– Et, et on te laisse tranquille, lui connais-tu des amis ici ?
– Ça fait longtemps qu’elle est partie et je ne fréquentais pas beaucoup ses amis. Mais je me souviens de Félix Lejardin, son ex, qui a changé d’bord en s’installant comme dépanneur dans le Village, rue Sainte-Catherine.
On se lève, on remercie, elle nous dit qu’on peut revenir quand on veut et nous re-voilà dehors. Décidemment, à Montréal, tout se passe rue Sainte-Catherine.
– On visitera le port plus tard. Tu vas découvrir le Village.

Le Village
Ici tu peux tout faire à pied à condition d’avoir le temps, d’aimer marcher et qu’il fasse beau. Ces trois conditions étant réunies, on passe sur la gare et on remonte la pente. On finira forcément par la croiser cette incontournable rue. On y arrive et, si je me repère bien, on part à l’opposé du chemin de chez nous. Mais bien vite, je me reconnais. C’est vite dit pour un lieu où je mets les pieds pour la première fois, mais toutes ces guirlandes, aux couleurs de l’arc en ciel LGBT, qui font un toit à la rue sont connues du monde entier. Le Village ! Une ambiance sans équivoque. Je comprends pourquoi les québécois gays, qui visitent le Marais, sont si dépités. Ici la gay-attitude est open, très bon-enfant et rassurante. L’amour circule. On a un nom, on sait que c’est un dépanneur mais, des dépanneurs, il y en a un tous les cinquante mètres. On n’a pas fini. Le premier, je ne saurais dire pourquoi, n’a pas une tête à s’appeler Félix. Mais, comme entre dépanneurs on se dépanne, il nous indique directement la voie. Remonter encore deux-cents mètres, juste à la limite où les guirlandes s’arrêtent et c’est sur le trottoir d’en face. Des boîtes à thème et des restos branchés défilent pendant nos pas rapides et on repère vite l’entreprise de dépannage en épicerie et produits de première nécessité de Lejardin. Une minuscule échoppe archibondée, écrasée entre deux vieilles maisons qui s’écroulent à moitié. Félix est grand, très grand. On ne peut pas le rater. Il ne semble même pas étonné de notre visite. La mère de Dorothée a dû retrouver son numéro de téléphone pendant qu’on crapahutait. Enfin un endroit où Vaness’ n’a pas la vedette ! Elle n’existe pas. Il n’a d’yeux que pour moi. Tellement que ça me gène. J’aime me prêter aux coutumes locales mais jusqu’à un certain point. On lui achète une bouteille d’eau pour rompre la glace. Un peu comme des colonisateurs offriraient une photo encadrée du général de Gaulle à des indigènes pour se les mettre dans la poche. L’entrevue (interview comme on dirait vers le Mont Royal, dans les quartiers anglophones) est courte. Oui, il connaît bien Doro, oui, il l’a revue il y a une semaine ou deux, elle l’a tapé de deux cent dollars. Non il ne sait pas où elle est partie ensuite. Peut-être vers la rue Saint-Denis où elle aurait des chances de trouver un job ou, alors, dans la « Petite Italie » car c’est son quartier préféré. Il propose, en rigolant, que Vanessa reste garder sa boutique et de m’accompagner dans les recherches. Ma collègue est très peu sensible à cet humour pas si innocent que ça. Le bonhomme nous raccompagne sur le trottoir en nous disant :
– Puisque vous avez sa photo, je vous conseille de traîner dans le quartier Latin et de la montrer à tous les marginaux… Il se reprend… C’est vrai que, là-bas, les marginaux ne sont pas ceux qu’on croit. Mais ça serait bien l’diâble si vous n’y croisiez pas quelqu’un qui l’aurait vue récemment.
La rue Saint-Denis, je ne sais pas pourquoi mais je sens que je vais aimer. Hasard ou signe des Dieux, elle est toute proche et monte doucement. On entre dans le quartier du street-art, des boîtes, de la vie nocturne. Si vous aimez le striptease, c’est la bonne adresse, en ne remontant pas trop. Après c’est plus l’ambiance restos-bistros. Sous le soleil, elle est magnifique cette rue. Il est presque treize heures et le thé d’Elisabeth est digéré. Pour manger, on a le choix mais Vaness’ est moins cyclothymique que moi en la matière. Elle nous colle dans la queue d’un bagel.
– Tu ne peux pas venir ici sans gouter un bagel !
– Bon, ben ça sera deux pour moi.

Pause déjeuner
C’est pas ce dont j’aurais rêvé mais ces petits pains ronds et troués, aromatisés de mille manières, complètent bien la bouteille d’eau qu’on a achetée chez Félix. On les engloutit, assis sur un banc à l’ombre d’un arbre, en regardant passer les gens. On a même la chance de trouver un vrai bistro comme chez nous avec un vrai zinc et de vrais expressos. Félix avait raison, les marginaux d’ici sont habillés comme vous et moi (surtout comme vous d’ailleurs), les autres, la grande majorité, c’est du grand n’importe quoi. J’adore ! On interpelle donc deux nanas percées et tatouées qui nous semblent assez proches de Doro dans le look. Elles ne la connaissent pas mais elles ne sont pas du quartier. Une des deux nous conseille d’aller chez Eva. C’est de là qu’elles reviennent.
– Qui est Eva ? demande ma compagne qui ne connaît pas tout le monde ici.
Les deux rigolent.
– C’est une boutique. Le spot de Montréal ! Rue Saint-Laurent. Vous prenez l’avenue des Pins et vous arriverez presque à la hauteur. Vous ne pouvez pas rater.
L’avenue des Pins est à deux pas. Nous la suivons sur trois-quatre cents mètres jusqu’à Saint-Laurent. Nous demandons. On nous indique. Rater Eva, c’est comme rater la tour Montparnasse en sortant de la gare du même nom. Ça en jette ! En bas, une boutique tellement tagguée qu’on ne voit rien à travers la vitrine. Pas un centimètre sans peinture. Et, au dessus-deux étages délirants avec des mannequins aux fenêtres, un décor ravageur. C’est quoi ça ?
– Tu ne connaissais pas ? que je m’étonne auprès de Vanessa.
– Ben non. Mais peut-être que ça n’existait pas à mon époque. Ça commence à remonter…
Elle réfléchit et compte sur ses doigts.
– Plus de dix ans maintenant. Ceci étant ça me semble être le bon endroit.
Trois étages aussi délirants à l’intérieur qu’à l’extérieur consacrés à la fripe, à la librairie, à la musique et à la restauration. Le tout très alternatif. C’est peu dire. J’ai un peu la même impression que si je rentrais en tutu dans un routier. Tout le monde me regarde ! Et puis, non, en vrai, tout le monde se fout de moi. On visite bêtement et on s’y plaît. Un bar, tout au fond, nous tend les bras de ses adirondacks (fauteuils de jardin caractéristiques d’Amérique du nord) dans une courette. La serveuse, auprès de laquelle Lisbeth Salander (lire l’excellent Millénium) passerait pour une première communiante, nous demande ce qui nous botterait. On ne sait pas trop. Elle propose du cidre de pomme chaud. On se laisse tenter. Elle nous le sert avec du pop-corn… épicé… et bien épicé. Vaness’ en profite pour lui coller la photo de notre cible sous le nez. Bien sûr qu’elle connaît !
– C’est Doro ! On a travaillé ensemble au Réservoir, une boîte dans l’coin. Mais ça fait un bail. Qu’est-ce qu’elle est devenue ?
– Vous n’avez pas eu de ses nouvelles dernièrement ?
– Non… ça doit faire au moins une paire d’années. Depuis elle a accroché ses patins. Qu’est-ce que vous lui voulez ?
– Lui annoncer une bonne nouvelle.
– Genre ?
– Qu’on a retrouvé son père.
– Ah ben vous êtes mourants, vous ! (rigolos) Vous avez essayé sa mère ?
– Oui c’est elle qui nous a conseillé de venir ici.
La nana n’a pas l’air payée aux pièces, elle s’installe à côté de moi. Ses genoux dépassent les miens de vingt bons centimètres. C’est une idée où ils sont grands ici ? Elle picore, en réfléchissant, dans notre bol de pop-corn.
– Elle en a mangé de la misère, ici, elle doit des dollars à presque tout le monde. M’étonnerait qu’elle y remette les pieds. Essayez à Jean-Talon.
Voulant faire mon intéressé et mon intéressant, je m’exprime :
– C’est qui celui-là ?
Vaness’ me balance un grand coup de coude et : « laisse tomber et paye. N’oublie pas le service.» Je ne comprends rien mais je ne cherche pas, je paye, on remercie la dame et on se lève. Dehors, je demande une explication. C’est qui le mec, quand même ?
– Jean-Talon, c’est pas un mec, c’est le marché de la Petite Italie. Mais là, j’en peux plus et c’est loin. On ira demain. On prendra le métro à Bonaventure, c’est en bas de chez nous et c’est direct.
– Tu as l’air de bien connaître.
Elle rigole et hausse les épaules :
– Il n’y a que toi qui ne connais pas Jean-Talon.
Vous connaissiez, vous ? On rentre et devinez par où ? Par Sainte-Catherine ! Pour le coup il est tôt quand on regrimpe notre escalier extérieur. À ce propos, la rue Saint-Denis est aussi le paradis pour ces drôles (mourants) escaliers qui redoublent d’imagination pour personnaliser les façades. Vaness’ m’explique que, si les escaliers sont ainsi installés dehors, c’est pour économiser de la place utile dedans. Je ne vois pas. Il suffisait d’avancer la façade en briques et le résultat était le même. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Mais c’est vrai que, sans eux, Montréal ne serait pas Montréal. Le décalage horaire fait son effet et, malgré un soleil radieux, je m’allonge deux minutes et dors deux heures. Ça fait un bien fou et je me réveille vaseux mais en meilleure forme. Vaness’ est sur son ordi. Juste en culotte et soutif. Je l’observe sans qu’elle ne s’en rende compte et je prends conscience, une fois encore, de la chance que j’ai. Ma levée (ou mon lever) du sofa attire son attention. Elle se retourne et me sourit.
– Viens, m’invite-t-elle.
Une bonne heure plus tard nous sommes prêts à affronter les rues parallèles et les rues perpendiculaires.
– Ça te dirait de voir le port ? On ne peut pas rater ça et demain on n’aura sans doute pas le temps. Et comme on redécolle après-demain…

Five Roses vu du port
On marche, on marche, on marche. On se retrouve devant la basilique Notre-Dame, toute proche de chez Elisabeth et on arrive par le tout-vieux Montréal sur la place Jacques-Cartier qu’on quitte pour les quais. Impressionnant ! Impressionnant d’ambiance, de vie, de décors. Le Fleuve Saint-Laurent n’est plus un mythe, il est là en face de moi et il tient ses promesses. On suit la promenade qui relie les quais. Quai Jacques-Cartier, quai King-Edward, quai Alexandra etc. La promenade du vieux port n’en finit pas de nous mettre dans l’ambiance. L’ile Sainte-Hélène, au milieu du fleuve. Face à nous l’ensemble architectural « Habitat 67 », qui me fait aussitôt penser aux Pyramides d’Evry, puis, en continuant les anciens bâtiments industriels qui ont fondé la richesse de la ville au début du siècle dernier. Dans leur jus, comme j’aime, mais souvent réaménagés en lieux culturels ou d’activité. Et puis, récompense suprême avant d’attaquer la sérénité du canal de Lachine, l’emblématique et imposante usine « Farine five roses ». Cette fin d’après-midi est caniculaire. Je ne m’attendais pas trouver, ici, une telle chaleur. On longe le canal où on croise de moins en moins de promeneurs et on remonte par des quartiers que je qualifierais de faubourgs. Les rues sont moins à angles droits, l’habitat plus épars et les quartiers en perpétuels chantiers. On monte et… Sainte-Catherine ! J’insiste pour que nous dînions dans la vaste zone souterraine que j’ai vue hier soir. Vaness’ ne se fait pas prier et nous engouffre, par une galerie que je n’aurais pas vue tout seul, dans les entrailles climatisées de la ville. On marche longtemps dans le deuxième sous-sol jusqu’à arriver à destination. Jolie ambiance conviviale. Nous sélectionnons nos plats, chacun dans un endroit différent, et nous nous retrouvons attablés en plein milieu de ce bazar. Sorte de hamburger géant avec des fines lamelles de viande pour moi, plus quelques frites, et salade géante pour Van’. Une glace pour faire glisser le tout et nous rentrons nous laver les dents. Douche. Bonne nuit !

Marché Jean Talon
Le métro est loin d’être si bondé qu’à Paris. Mais il est vrai aussi que dix heures ont sonné quand on sortait du Starbucks à proximité de la station Bonaventure. Dix stations plus loin et on sort. Ailleurs. La Petite Italie. Un quartier devenu branché où règne une ambiance vraiment méditerranéenne. Des cafés, des trattorias et, clou du secteur, le marché Jean-Talon qui mérite vraiment sa réputation internationale (puisque qu’il semblerait qu’il n’y a que moi qui ne connais pas). On visite, on s’imprègne. Ça grouille et ça crie comme là-bas. La terrasse d’un petit café, sur la périphérie de la place nous invite à nous poser. Pour le coup l’expresso est bien italien, un centimètre au fond de la tasse. J’aurais dû demander un double. Le patron, qui n’a d’italien que le pseudo et surtout pas l’accent, nous semble bien ancré dans la zone. Tout le monde fait un détour pour venir le saluer, les jeunes désœuvrés comme les mémères à cabas. Nous lui proposons donc notre photo quand il nous dépose nos tasses qu’il ne risque pas de renverser. Il regarde attentivement Doro et se gratte la tête.
– C’est pas quelqu’un du coin. Je la connaitrais sinon, mais… attendez un peu… Si ! Bien sûr que si ! Je l’ai vue à la caisse d’Archambault.
– C’est quoi Archambault ?
– La grande librairie, juste de l’autre côté du marché. Vous ne pouvez pas la rater, elle occupe presque toute la longueur de la rue.
Nous voilà debout en moins de deux, comme on dit chez nous. Je paye, j’abonde largement pour le service et on retraverse le marché entre les étals multicolores. Louper Archambault c’est pas possible : un grand immeuble en briques rouges et une enseigne mahousse. La partie basse, au rez de chaussée, est joliment taguée d’épis de blé sur un fond contrasté. Faut deviner qu’il s’agit d’une librairie. J’aurais plutôt imaginé une entreprise de bureau. Nous y pénétrons et l’évidence nous saute aux yeux : Dorothée, impossible de se tromper, est installée à une caisse du fond de cette caverne d’Ali Baba. Elle jase avec un barbu tatoué en short à franges. Il lui colle deux becs et dégage. La voie est libre et nous nous y engouffrons. Vaness’ attaque :
– Dorothée ?

La librairie Archambault
La caissière nous dévisage.
– On se connaît ?
– Pas encore mais dans cinq minutes, on pourra plus s’quitter.
La gamine a l’air méfiante (j’arrive pas à écrire « a l’air méfiant ») mais elle est coincée dans son bouclard. Son regard est aussi interrogateur qu’inquiet. C’est qui, eux ? Des créanciers ? Des agents du fisc ? Un ancien logeur ? J’interromps sa cogitation :
– On a plutôt de bonnes nouvelles et on vient de France exprès pour vous les annoncer. On ne pourrait pas se voir quelque part ?
Elle regarde autour d’elle, hésitante. Puis nous regarde. Puis décroche son téléphone. Appelle-t-elle la sécurité ? Son avocat ? L’ambassade ? Non, juste un : « tu peux me remplacer un quart d’heure ? » et elle raccroche. Le barbu radine. Ça n’était pas un client mais un collègue qui prenait son service. Sans doute un descendant de bucheron, mais très sympathique comme le sont toujours les québécois. Il ne pose pas de question et se badge sur la caisse de Doro. On retraverse le marché en suivant les pas de Dorothée et on arrive dans notre bistro de tout à l’heure. Le faux Gino nous reconnaît :
– Ah ben, vous l’avez retrouvée, vot’blonde !
On commande des double-expressos et on s’installe en terrasse. La fille Lamour est décontractée. Short élimé et tee-shirt ajouré. J’aime bien ce pays. La tête de sa mère en plus juvénile. Forcément. J’ai peu connu son père, sauf sur Paris-Match, alors je ne peux pas dire.
– Bon, j’ai dix minutes.
– Dix minutes qui vont changer votre vie, lui assure Vaness’ avec assurance (visez l’exercice de style !)
– J’ai gagné à la loterie ?
– Mieux que ça…
Et ma copine lui raconte tout de A à Z pendant que je bois mon café. J’aurais dû demander un triple. Incrédule, suspicieuse, Doro gigote sur fauteuil en rotin.
– T’es sûre ?
– Sinon on ne serait pas là.
– Ben dites-donc, ça torche votre truc ! On fait comment maintenant ?
– On a un billet de retour « open ». Tu rentres quand tu veux et tu prends contact avec monsieur Yldiz pour les formalités et le contrat. Il te mettra en relation avec Maître Saint-Kant, le notaire chargé de la succession.
Elle lui tend l’enveloppe préparée, à son intention, par le généalogiste et qui contient billet d’avion et divers documents explicatifs.
– Je vous suis…
– Vous… tu ne préviens pas ton employeur ?
– Si… Tu as raison, je vais même finir ma journée. Faut être correcte. Vous décollez quand ?
Demain, à Trudeau, à 20 heures.
– Enregistrez-moi, s’il vous plaît, je rentre avec vous.
Nous partîmes à deux, vers chez nos cousins, et nous revenons à trois au bercail. Après une dernière journée touristique durant laquelle nous avons surtout flâné, en amoureux, autour du Mont-Royal et dans les allées paisibles du cimetière de Notre-Dame des Neiges en poussant jusqu’à l’oratoire Saint-Joseph (mélange de Sacré-Cœur et de Taj Mahal), nous revoilà en zone d’embarquement avec une nouvelle amie. Elle en a des choses à raconter, du haut de ses vingt-cinq ans, la gamine ! De quoi écrire un livre. Et dire que ça ne fait que commencer pour elle. Puisse cet héritage saugrenu la conserver toujours telle qu’elle est ! Elle a déjà le projet de refaire le monde. C’est un bon début. Nous, on rentre. Vaness’ propose à Doro de l’héberger durant ses formalités. Momo et René seront à l’arrivée.
Trois jours sur place, juste le temps de digérer ma poutine.





0 commentaires